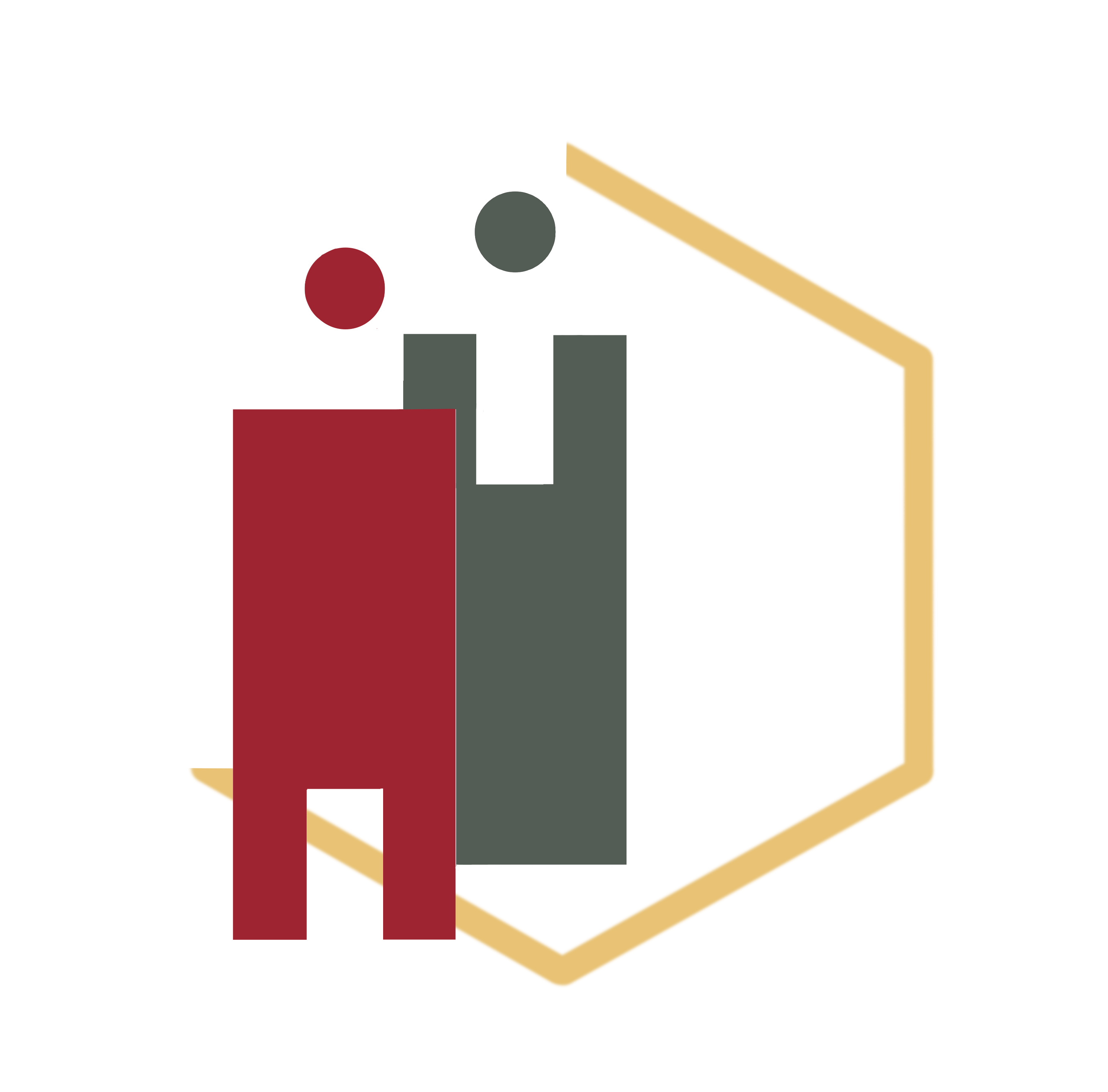Alors que le quinquennat de l’actuel président de la République française se termine, Dalloz actualité a souhaité retracer, à travers une série d’entretiens, les grandes évolutions juridiques à l’œuvre durant ces cinq dernières années sous l’effet conjugué de l’action des pouvoirs exécutif et parlementaire, voire des décisions de justice, et réfléchir aux évolutions à venir. Focus sur l’évolution du droit des personnes et de la famille.
Le droit des personnes et de la famille aura fait l’objet de nombreuses réformes durant ces cinq dernières années. La volonté affichée de mieux tenir compte des évolutions sociétales et nouveaux modes de conjugalité, de protéger les plus vulnérables – sujet que nous aborderons essentiellement par le prisme des majeurs vulnérables, les questions de la protection des mineurs et des violences conjugales faisant l’objet d’autres articles – et de rendre la justice plus efficace s’est traduite au plan législatif par l’adoption de plusieurs textes tout au long du quinquennat, avec une nette accélération ces derniers mois. Dès le 25 mars 2019, l’article 32 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a conféré au juge aux affaires familiales le pouvoir de statuer sur la jouissance provisoire du logement de la famille en cas de séparation de parents non mariés. La réforme de la bioéthique, on le sait, a quant à elle connu un parcours beaucoup plus chaotique, à tel point que, même les plus optimistes, ont fini par craindre qu’elle ne voit jamais le jour. La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique fut pourtant bien promulguée, suivie sept mois plus tard de la loi n° 2022-92 du 31 janvier 2022 interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne. Se sont ensuite enchaînées la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants (dont P. Bonfils et A. Gouttenoire ont déjà dressé un bilan, v. Dalloz actualité, 10 mars 2022), la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption et, en tout dernier lieu, la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, que nous ne traiterons pas ici, mais qui assurément facilitera le changement de nom en faveur du parent qui n’aura pas transmis le sien tout en constituant une entorse supplémentaire au principe d’immutabilité du nom. Retour sur quelques-unes des mesures les plus emblématiques de ce quinquennat avec Florent Berdeaux, avocat et président de l’Association française des avocats de la famille et du patrimoine, Frédérique Eudier, professeur émérite, Fadela Houari, avocate, et Sophie Spens, magistrate.
La rédaction : Maître Berdeaux, parmi les mesures de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, quelle est celle qui retient le plus votre attention ?
Florent Berdeaux : Grande loi sociétale, la révision de la loi de bioéthique est devenue le sujet dont personne ne semblait vouloir s’emparer, en raison de l’importance que la question de l’ouverture de la « PMA pour toutes » a prise dans le débat. D’autres sujets pourtant essentiels, tels que l’accès aux origines, les dons d’organes, la recherche ou les liens entre neuroscience et intelligence artificielle figurent aussi au sommaire de la loi. C’est pourtant cette ouverture de la PMA à toutes les femmes qui retient l’attention, tant elle correspond à une aspiration fondamentale d’une partie de la population et entraîne l’aversion d’une autre. C’est désormais chose faite : les femmes célibataires ou en couples de même sexe pourront, elles aussi, avoir recours à la PMA, à condition d’être âgées de moins de 43 ans (pour une ponction d’ovocyte) ou 45 ans (pour une insémination).
La question de l’accès à la PMA a beau avoir été la plus discutée, la plus symbolique, elle cachait la discussion hautement plus technique relative aux conséquences de cette réforme sur le droit de la filiation, et plus précisément aux modalités d’établissement de la filiation envers la mère n’ayant pas accouché (puisque la mention de l’accouchement suffit, quant à elle, pour la mère biologique, même en présence d’un don d’ovocyte) : fallait-il lui demander d’adopter son enfant (comme l’ont fait toutes les femmes ayant eu recours à la PMA à l’étranger avant la loi, mais ce que les intéressées refusaient pour la plupart, tant le projet d’un couple ayant recours à la PMA est éloigné d’un projet d’adoption), ou pouvait-on calquer le droit qui était jusqu’alors applicable aux couples hétérosexuels (consentement signé devant notaire, puis reconnaissance par le père non génétique) ? À l’inverse, pouvait-on vraiment prévoir un mode d’établissement de la filiation spécifique pour les couples de même sexe, qui ne soit pas celui des autres couples ?
C’est cette dernière voie, hybride, qui a été choisie : les couples devront se rendre chez le notaire pour y faire une reconnaissance conjointe anticipée, qui sera présentée à l’officier d’état civil le jour de la déclaration de naissance, lequel officier mentionnera alors sur l’acte que la filiation est établie envers les deux mères, au vu de cette reconnaissance conjointe notariée. Un établissement de la filiation efficace, rapide et ne dépendant pas d’un juge (combien de couples se sont sentis humiliés d’avoir à quémander l’adoption ?), mais stigmatisant (les enfants sauront nécessairement qu’ils sont nés par PMA, et l’on rétorquera qu’ils ne pourront pas l’ignorer en présence de deux mères…) et discriminant (pourquoi n’avoir pas prévu la même chose que les couples hétérosexuels, si ce n’est… précisément pour ne pas aligner les deux situations ?). Encore une conséquence bancale, en la matière, de la doctrine « en même temps », chère à la législature sortante…
La rédaction : Mme le professeur Frédérique Eudier, quelle appréciation faites-vous de l’évolution du droit des personnes vulnérables, notamment s’agissant des majeurs protégés ?
NDLR : Sur l’évolution du droit des mineurs, v. P. Bonfils et A. Gouttenoire, Quinquennat Macron : quelle évolution du droit des mineurs ?, Dalloz actualité, 10 mars 2022 ; sur l’évolution de la lutte contre les violences sexuelles, v. A. Darsonville, M. Dosé et J.-P. Rosenczveig, Quinquennat Macron : quelle évolution de la lutte contre les violences sexuelles ?, Dalloz actualité, 11 mars 2022.
Frédérique Eudier : Un « vent émancipateur » (selon l’expression du professeur Noguéro), venu de New York, a soufflé en France en 2019. Sous l’impulsion du Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies, du Défenseur des droits et du groupe de travail présidé par Mme Caron Déglise, le législateur a été conduit à renforcer les droits fondamentaux des majeurs protégés et leur a conféré davantage d’autonomie. En ce qui concerne l’exercice de la citoyenneté, le pouvoir conféré au juge, par l’article L. 5 du code électoral, de priver la personne sous tutelle de son droit de vote avait été jugé discriminatoire et contraire à l’article 12 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH). Le 9 juillet 2018, dans un discours prononcé devant les parlementaires réunis en Congrès à Versailles, le président Macron avait d’ailleurs annoncé « une politique de retour vers la citoyenneté pleine et entière » des majeurs protégés et, notamment, un « retour au droit de vote » des majeurs en tutelle. L’article 11 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a abrogé l’article L. 5 du code électoral. Depuis le 25 mars 2019, un majeur en tutelle est titulaire d’un droit de vote inconditionnel qu’il exerce personnellement (C. élect., art. L. 72-1 nouv., al. 1er). Cependant, il ne suffit pas d’être titulaire d’un droit. Encore faut-il pouvoir l’exercer effectivement. À cet égard, la réglementation des procurations ne favorise pas cet exercice effectif même si on peut comprendre que le législateur ait voulu prévenir les abus d’influence. Le tutélaire ne peut donner procuration à son tuteur professionnel, à une personne ayant un lien avec l’établissement qui le prend en charge ou à un salarié intervenant auprès de lui au titre des services à la personne (C. élect., art. L. 72-1 nouv., al. 2). Dans un certain nombre de cas, le majeur protégé risque de ne pouvoir donner une procuration, notamment lorsqu’il est hébergé dans un établissement. Par ailleurs, l’article L. 200 du code électoral prohibant l’élection des majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle, jugé non conforme à la CIDPH par le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies, n’a pas été abrogé. À l’instar des membres du groupe de travail piloté par Caron Déglise, le législateur a estimé que la question de l’éligibilité pouvait être dissociée de celle du droit de vote. Le chemin vers la « citoyenneté pleine et entière » est donc encore semé d’embûches.
L’article 4 de la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation a modifié l’alinéa 1er de l’article 60 du code civil afin de permettre au majeur sous tutelle de présenter lui-même une demande de changement de prénom à l’officier de l’état civil. Le majeur protégé jouit également d’une plus grande autonomie pour l’exercice de ses droits familiaux. L’article 10 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a ainsi supprimé l’autorisation de mariage exigée auparavant qui avait pourtant reçu un brevet de constitutionnalité (Cons. const. 29 juin 2012, n° 2012-260 QPC, D. 2012. 1675 ; ibid. 1899, point de vue G. Raoul-Cormeil
; ibid. 2699, obs. D. Noguéro et J.-M. Plazy
; ibid. 2013. 1089, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau
; AJ fam. 2012. 463, obs. T. Verheyde
; RTD civ. 2012. 510, obs. J. Hauser
) et de conventionnalité (CEDH 23 oct. 2018, n° 37646/13, Delecolle c. France, Dalloz actualité, 15 nov. 2018, obs. N. Peterka ; D. 2019. 910, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau
; ibid. 1412, obs. J.-J. Lemouland et D. Noguéro
; AJ fam. 2018. 693, obs. G. Raoul-Cormeil
; RTD civ. 2019. 80, obs. A.-M. Leroyer
) en matière de curatelle. La personne chargée de la protection du majeur doit être informée par le majeur protégé du projet de mariage (C. civ., art. 460) et la publication des bans est subordonnée à la remise de la justification de cette information (C. civ., art. 63, 1°). Le tuteur ou le curateur, à condition qu’il soit réellement informé et réactif, peut alors former une opposition au mariage (C. civ., art. 175). Cette opposition, qui a un coût puisqu’elle doit être signifiée, lui permet d’invoquer un empêchement légal au mariage, essentiellement le défaut ou le vice du consentement. Elle ne lui permet pas de contester l’opportunité de l’union. Un mandataire judiciaire à la protection des majeurs va-t-il se lancer dans ce processus susceptible de déboucher sur une procédure lourde en mainlevée de l’opposition devant le tribunal judiciaire, au risque de voir sa responsabilité engagée ? Rien n’est moins sûr et on peut douter que ce dispositif légal assure effectivement la protection des intérêts du majeur d’autant que ses descendants ne sont pas admis à former une opposition au mariage. La personne en charge de la mesure de protection peut toujours, conformément à l’article 1399, alinéa 3, du code civil, demander au juge des tutelles l’autorisation de conclure « seule » une convention matrimoniale pour mettre les biens du majeur à l’abri. Il faut qu’elle soit, là encore, très réactive et que le futur conjoint du majeur protégé soit d’accord… Outre le fait que cette disposition n’est pas du tout conforme à l’objectif de promotion de l’autonomie du majeur protégé, elle est difficilement applicable dans la pratique.
Sous couvert de promotion des droits fondamentaux du majeur protégé, le législateur a accéléré le désengagement de l’autorité judiciaire dans sa protection. Ce désengagement peut être également constaté dans le domaine patrimonial, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes de tutelle. L’article 30 de la loi du 23 mars 2019 a supprimé le contrôle du directeur des services de greffe judiciaires, défaillant faute de moyens, pour lui substituer un contrôle interne des personnes en charge de la mesure de protection et, dans certains cas, d’un professionnel qualifié, qui générera des coûts pour les personnes protégées.Sous couvert de la confiance accordée aux familles et aux mandataires judiciaires, la collectivité publique se décharge de ses missions. Elle n’accomplit plus correctement son « devoir » (C. civ., art. 415, al. 4) de protection des majeurs vulnérables.
Cependant, le balancier oscille encore entre l’exigence d’autonomie et l’exigence de protection de l’intérêt du majeur vulnérable. La loi du 23 mars 2019 a ouvert le divorce accepté au majeur protégé. Celui-ci peut désormais accepter seul le principe de la rupture du mariage (C. civ., art. 249) mais c’est le juge qui statue sur les conséquences du divorce. Le législateur a plutôt réussi ici à concilier l’autonomie du majeur protégé et la protection de ses intérêts, ce qui relève souvent de la quadrature du cercle. En outre, l’exigence de protection du majeur vulnérable, rappelée lors des débats relatifs à la proposition de loi de réforme de l’adoption, a conduit les parlementaires à renforcer le rôle du juge en la matière. En vertu de l’art. 458 du code civil, « le consentement donné à sa propre adoption » est un acte strictement personnel qui ne peut jamais donner lieu à une assistance ou à une représentation de la personne protégée. Cependant, le nouvel article 348-7 du code civil, créé par l’article 7 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption, autorise le juge à prononcer l’adoption d’un majeur protégé, « hors d’état d’y consentir personnellement », après avoir recueilli « l’avis » de la personne chargée de la mesure de protection si celle-ci inclut une représentation de la personne. Le nouveau texte rappelle une évidence : l’adoption doit être « conforme à l’intérêt de l’adopté ».
La rédaction : Maître Berdeaux, la réforme du droit de l’adoption, finalisée en ce début d’année, vous semble-t-elle satisfaisante ?
Florent Berdeaux : La réforme de l’adoption par la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 n’a pas suscité de débats particuliers, tant les dispositions qu’elle contient ont surtout eu vocation à moderniser le régime de l’institution qui, il est vrai, semblait vieillissant : réserver l’adoption aux célibataires ou aux couples mariés n’avait plus, en 2022, la moindre justification sociétale. Elle est donc désormais ouverte aux couples non mariés qui peuvent justifier d’une communauté de vie d’un an (disposition qui s’applique aussi aux époux, en lieu et place de la durée de deux ans de mariage antérieurement exigée). Parmi quelques autres retouches (l’âge limite de 15 ans pour une adoption plénière est supprimé en cas d’adoption de l’enfant du concubin, partenaire ou conjoint), un nouvel alinéa de l’article 348-3 du code civil dispose notamment que le consentement du parent doit être obtenu sans aucune contrepartie… on pense donc à la GPA : serait-ce une façon détournée d’interdire l’adoption plénière par le parent d’intention (puisque la mère porteuse a obtenu une contrepartie) ? Si oui, cet alinéa va créer une nouvelle forme de discrimination et entraîner la condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme. Une discrimination entre les enfants nés de GPA réalisés dans les pays de l’Est (Russie, Ukraine où la mère porteuse figure sur l’acte de naissance et doit donc bien consentir… mais a reçu une contrepartie, ce qui priverait donc son consentement de valeur) et les États-Unis ou le Canada (où la mère porteuse n’aura jamais figuré sur l’acte de naissance, n’aura donc jamais été la mère légale et n’aura pas à consentir, bien qu’elle ait reçu une contrepartie). Quant à la condamnation de la CEDH, elle est certaine dès lors que la reconnaissance de la filiation d’intention est la règle ; or, si l’adoption n’est plus possible faute de consentement, et que la transcription de l’acte étranger est désormais interdite, que resterait-il pour respecter les directives de la Cour ? L’exequatur, s’il existe une décision judiciaire ? S’il n’en existe pas (comme dans certaines provinces du Canada) ?
Bien que transitoire, une autre disposition de la loi retient l’attention, en ce qu’elle prévoit qu’au sein des couples de femmes ayant eu recours à la PMA à l’étranger pour concevoir un enfant, celle qui ne figurera pas sur l’acte de naissance mais se sera vu refuser par son ex-compagne d’avoir recours à la reconnaissance conjointe créée par la loi bioéthique pour établir la filiation, pourra alors passer outre ce refus et solliciter l’adoption de l’enfant dont elle est la mère sociale. Un pis-aller bienvenu pour ces mères sans droits, mais un pis-aller quand même, conséquence du refus d’ouvrir simplement la reconnaissance, telle qu’on la connaît depuis longtemps, aux couples de même sexe.
On le voit décidément à nouveau, entre PMA et adoption, les retouches partielles et idéologiques qui concernent le droit de la filiation dans son ensemble sont source de contradiction, et d’affaiblissement du régime général. La filiation mérite une réforme d’ensemble, à laquelle il semble manifestement difficile de se confronter.
La rédaction : Mme Spens, quelle appréciation portez-vous sur l’évolution de l’efficacité de la justice familiale ?
Sophie Spens : L’accélération des procédures, spécialement celle du divorce et du changement de régime matrimonial, comme le renforcement de l’exécution des décisions en matière d’autorité parentale sont des objectifs louables. Mais, lorsqu’ils s’accompagnent d’une déjudiciarisation toujours plus prégnante, ils finissent par inquiéter et faire douter des priorités étatiques, avec encore plus d’appréhension lorsque l’on songe aux nombreux dysfonctionnements que la crise sanitaire a exacerbés.
S’agissant de la réforme de la procédure de divorce, elle est globalement très positive et permet d’obtenir une décision dans des délais considérablement diminués. La première audience statuant sur les mesures provisoires a été maintenue et les parties peuvent s’y présenter. La présence obligatoire d’un avocat à cette première audience est un grand progrès et renforce le rôle des avocats. En pratique, au tribunal judiciaire de Metz, en accord avec le barreau, nous demandons à ce que les parties soient présentes. Bien évidemment, si les parties n’ont qu’un différend financier ou au contraire sont d’accord sur tous les points, les avocats peuvent les représenter.
La demande de divorce à proprement parler comporte une amélioration puisque le délai de séparation pour un divorce 237 est réduit à un an (au lieu de deux).
Le fait que le dossier fasse l’objet d’un renvoi en mise en état directement avec le prononcé de l’ordonnance sur mesure provisoire est un gain de temps notable.
Auparavant, un divorce 233, sans difficulté voire avec un accord global, nécessitait un an de procédure en moyenne (au TJ de Metz). Actuellement, le même dossier peut être jugé en quatre à six mois.
Nous en sommes au début de l’application de cette réforme et il n’est pas impossible que des difficultés non envisagées surviennent, notamment quant à l’impossibilité pour le défendeur de conclure au fond lorsque le demandeur n’a pas précisé le fondement de sa demande.
En tout état de cause, à ce stade, cette réforme est globalement très positive à tout point de vue : délais raccourcis, procédure simplifiée, rôle accru de l’avocat, etc.
La rédaction : Qu’en est-il notamment sur le terrain du recouvrement des pensions alimentaires, avec la mise en place du dispositif d’intermédiation financière ?
Sophie Spens : L’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) a très peu été utilisée depuis sa mise en place il y a un an environ. Le 1er mars 2022, cette mesure est devenue systématique pour les divorces judiciaires. Il me semble, avec le recul, qu’il s’agit d’une bonne mesure car l’aspect financier reste toujours au cœur de l’ancien couple et c’est une source de conflit et de tension supplémentaire quand la pension n’est pas payée en temps et heure, ne serait-ce qu’à une date aléatoire dans le mois ou en plusieurs fois dans le mois. Bien souvent, le créancier considère que la somme allouée n’est pas suffisante, le débiteur considérant qu’elle est toujours trop élevée… la tension est donc déjà latente. Pour ne pas envenimer les choses, le créancier renonce souvent à réclamer un paiement total et l’indexation. Il existe certes des voies d’exécution pour les créances alimentaires mais un paiement direct est mal vécu et ne fait que rejaillir sur la situation familiale. La mise en place systématique de l’IFPA évite ces tensions et va probablement simplifier les relations familiales en évacuant la question du paiement des pensions alimentaires, étant précisé que d’un commun accord les parties peuvent renoncer à la mise en place de cette mesure.
Côté tribunal, la mise en place systématique de l’IFPA représente une charge de travail supplémentaire importante qui pèse quasi exclusivement sur le greffe qui doit transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales l’ensemble des éléments permettant l’application de cette mesure et assurer le suivi de la notification de la décision.
Il avait été annoncé des moyens pour la mise en œuvre de cette réforme au 1er mars 2022. Cela se traduit souvent uniquement par la possibilité d’embaucher un contractuel qui n’a ni la formation ni les compétences d’un greffier et dont le contrat ne dépasse pas trois ans. Cela est nettement insuffisant eu égard au sous-effectif chronique dont souffrent les tribunaux.
La rédaction : Et que pensez-vous des mesures visant au renforcement de l’exécution des décisions rendues en matière d’autorité parentale ?
Sophie Spens : Je suis réservée sur l’utilité de la mesure de médiation post-sentencielle. Lorsqu’une décision est intervenue, les parties ne voient en général plus aucun intérêt à la médiation, à tort parfois. En pratique, cette mesure n’est pas ordonnée. Une mesure de médiation suppose une réelle volonté de dépasser un conflit pour faire évoluer sa position en acceptant d’écouter l’autre. C’est peu le cas en pratique. Cette mesure pourrait être bonne dans le principe mais peu compatible avec la réalité des tribunaux et des conflits qui s’y présentent. Quant aux sanctions pécuniaires et au recours à la force publique, il s’agit de mesures exceptionnelles qui concernent des situations exceptionnelles.
La rédaction : Quelle appréciation portez-vous de la réforme relative au changement de régime matrimonial ?
Sophie Spens : La réforme de 2019 a supprimé le délai de deux ans pour pouvoir changer de régime matrimonial, ainsi que l’obligation d’homologation judiciaire en présence d’enfant mineur. Les époux doivent s’adresser à un notaire, pour enregistrement et conseil, s’ils souhaitent procéder au changement de leur régime matrimonial, que celui-ci soit, ou non, soumis à l’homologation du juge. Ils peuvent également s’adresser à un avocat pour obtenir un conseil et pour effectuer les formalités nécessaires à l’homologation. La vérification de la conformité du changement envisagé à l’intérêt de la famille incombe en premier lieu au notaire. Le juge aux affaires familiales n’intervient plus qu’en cas d’opposition d’un tiers (enfant majeur ou créancier). Le juge des tutelles peut également être saisi par le notaire si la modification envisagée méconnaît l’intérêt de l’enfant mineur. La réforme du changement de régime matrimonial accroît donc le rôle de conseil du notaire et de l’avocat, le juge aux affaires familiales n’intervenant plus qu’en cas de conflit. La procédure est donc grandement simplifiée et plus rapide pour les justiciables.
La rédaction : Maître Berdeaux, l’attribution de la jouissance du logement familial dans le cadre de la séparation des gens non mariés était l’une des dispositions attendues du quinquennat ; les mesures envisagées ont-elles permis de répondre aux attentes ?
Florent Berdeaux : L’intervention du juge aux affaires familiales dans le cadre des relations entre personnes non mariées n’est pas nouvelle : la liquidation des intérêts patrimoniaux des partenaires de pacs ou des concubins ressortit ainsi à la compétence de ce juge (COJ, art. L. 213-3) sans que l’on songe, aujourd’hui, à y redire : le mariage n’est plus le critère discriminant dès lors que la vie de couple, en elle-même, est source de rapports juridiques et d’enjeux humains qui se mêlent aussi bien les uns aux autres avec ou sans mariage. Dès lors que le juge aux affaires familiales n’est plus, depuis longtemps, celui aux affaires matrimoniales, il n’y a rien là que de très logique. De la même façon, il y a fort longtemps que le juge intervient dans les relations parentales sans aucun égard au statut matrimonial des parents : l’existence du mariage implique, certes, un cadre procédural propre qui est celui du divorce, mais le fond du droit et des mesures à prendre est identique.
Le logement familial continuait pourtant à avoir un statut à part, puisqu’il n’était envisagé qu’à travers les règles du mariage, qu’il s’agisse de l’article 215 du code civil (sur le choix dudit logement, et les pouvoirs des époux à son égard) ou de l’article 255 (sur l’attribution de la jouissance pendant la procédure).
La question de l’attribution de la jouissance du domicile est, pourtant, aussi essentielle pour les partenaires ou concubins que pour les époux : dans tous les cas, la séparation bouleverse le cadre de vie de la famille (ou au moins d’un des membres du couple) comme l’équilibre budgétaire, dont le logement est certainement l’élément principal. Malgré tout, si ce n’est à travers le prisme de l’ordonnance de protection, qui demeure assez étroit, le juge n’avait pas les moyens de statuer sur l’attribution du logement de la famille dans le cadre de la séparation : le droit de propriété (en présence d’un logement personnel à l’un des deux membres du couple), ou de l’indivision s’appliquaient classiquement.
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, créant un article 373-2-9-1 du code civil, prévoit désormais que le juge peut attribuer à l’un ou l’autre des parents non mariés la jouissance du domicile conjugal ; cette disposition était attendue.
Néanmoins, force est de constater qu’elle ne répond que très partiellement à l’attente, en premier lieu parce qu’il s’agit d’une disposition relevant de l’encadrement de l’exercice de l’autorité parentale entre parents séparés et non pas de celui de la séparation des membres du couple : sans enfant, les pacsés ou les concubins restent toujours sans aucune solution relative au logement du couple (alors que les dispositions propres au mariage sont liées à ce statut, non à la présence d’enfants). En second lieu, la mesure n’est envisagée qu’à titre provisoire puisqu’elle ne serait valable que six mois, sauf à être suivie d’une demande de prorogation accompagnant une assignation en liquidation partage de l’indivision (qui ne concerne donc que les couples propriétaires). On est loin d’une réforme d’ensemble du statut si spécifique du logement conjugal.
La rédaction : Mme le professeur Eudier, que pensez-vous de l’évolution du processus de déjudiciarisation à l’œuvre en matière de justice familiale ?
Frédérique Eudier : La loi du 23 mars 2019 a poursuivi le processus de déjudiciarisation déjà engagé par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Le législateur a souhaité « développer la culture du règlement alternatif des différends » pour « favoriser des modalités plus apaisées et plus rapides de règlement des différends entre les citoyens » et pour « alléger l’activité des juridictions » (rapport annexé au projet de loi, p. 6). Le développement de la « culture du règlement alternatif des différends » passe par la contrainte et l’usage de la fin de non-recevoir avec l’introduction de la tentative préalable obligatoire de résolution amiable du litige dans le domaine des conflits de voisinage ou lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 € (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 4, et C. pr. civ., art. 750-1). Encore faut-il que les justiciables puissent accéder effectivement aux modes alternatifs de règlement des différends et, notamment, à la conciliation. Le législateur a eu conscience des difficultés pratiques de mise en œuvre des nouvelles dispositions. Il a, en effet, autorisé le justiciable à invoquer « l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige » comme motif légitime ayant empêché la tentative de résolution amiable du litige (C. pr. civ., art. 750-1, 3°). L’interprétation de la notion de « délai manifestement excessif » peut poser problème.
Plus généralement, en la matière, l’incitation n’est-elle pas préférable à la contrainte sous peine de transformer la tentative de règlement amiable du litige en une « simple formalité dont les parties justifieraient par une attestation » (F. Agostini et N. Molfessis, Amélioration et simplification de la procédure civile, 2018, p. 25) ?
Le législateur s’est attaché à réduire le périmètre d’intervention du juge, comme si, « pour lutter contre la lenteur de la barque de la justice, il suffisait d’alléger sa cargaison » (D. Landry, De l’allègement au déni de justice, Gaz. Pal. 11 janv. 2014, p. 11). L’objectif principal étant l’allègement de l’activité juridictionnelle, le juge doit se recentrer sur « sa mission première de règlement des différends » (F. Agostini, N. Molfessis, rapp. préc., p. 16). Il est à craindre que la juridiction gracieuse soit progressivement vidée de sa substance. L’autorité publique se décharge de ses missions sur les professionnels du droit, notamment sur le notaire qui devient même un « lanceur d’alerte ». Ainsi, il lui incombe de saisir le juge des tutelles si les intérêts patrimoniaux du mineur sont « manifestement et substantiellement » compromis dans le cadre d’un changement de régime matrimonial désormais déjudiciarisé (C. civ., art. 387-3, al. 2, par renvoi de l’art. 1397, al. 5).
En droit de la famille comme ailleurs, déjudiciarisation rime avec privatisation.
La rédaction : Maître Houari, quel a été, selon vous, l’impact de la crise sanitaire sur la justice familiale ?
Fadela Houari : La crise sanitaire a été un révélateur de l’état de la justice en France. D’abord, il nous a été permis de constater le peu de considération de cette institution puisque le 15 mars 2020 était annoncée la fermeture des tribunaux, considérés comme non essentiels. Grands oubliés des listings à la Prévert rédigés par l’exécutif, et donc non essentiels, les espaces de rencontre ont fermé, ce qui a nécessairement impacté les enfants et les parents, les délais – déjà longs – pour obtenir un rendez-vous, ayant considérablement augmenté à compter du déconfinement. L’assistance éducative n’était pas plus essentielle. Les décisions ont été prolongées automatiquement sans que les parents ni les enfants ne soient reçus. Pire, des mineurs isolés étrangers se sont vu refuser leur demande de prise en charge hors leur présence (ce qui interpelle alors qu’il s’agit d’évaluer leur minorité) et hors les explications de leur avocat·e qui n’avaient pas accès au tribunal, la question du respect d’un procès équitable n’ayant pas effleuré les juges des enfants, lesquels ont – trop – scrupuleusement respecté les plans de continuation (PCA). Dans le cadre de la mise en œuvre des plans de continuité, les avocats ont constaté des dysfonctionnements à géométrie variable d’un tribunal à l’autre, consécutifs à des divergences de position des chefs de Cour, et donc des approches territoriales parfaitement différenciées. La crise a initié une chute brutale des nouvelles affaires durant le premier confinement, multiplié les cas de procédure sans audience, impacté la qualité de la justice rendue en augmentant les délais, révélé l’insuffisance de la prise en charge des publics vulnérables, malgré les efforts pour accorder la priorité aux situations aggravées (les violences familiales notamment).
La crise a donc été un révélateur des faiblesses (rapport de la Cour des comptes sur le plan de continuité d’activité des juridictions judiciaires pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19) et démontré que le numérique ne suffit pas faute de moyens donnés aux greffes et aux magistrats. Les reprises n’ont pas endigué ces difficultés et en ont révélé d’autres, impactant au quotidien notre pratique en droit de la famille. Une justice qui était annoncée comme se voulant simple, efficace, moderne et proche des gens, se révèle complexe, allongée, en chantier, faisant l’objet de crash tests et correctifs réguliers. La complexité des réformes de procédure civile a rendu les justiciables fébriles (le nombre de dossiers portés au tribunal a diminué) sans pour autant guérir les maux. L’inflation managériale a infecté nos relations de travail et impacté les pratiques en matière familiale, les délais se sont trop considérablement allongés, décourageant plus d’un justiciable.
Certains espèrent ou prédisent une renormalisation du flux juridictionnel tandis que d’autres promeuvent la médiation conventionnelle comme un rempart, la solution ultime qui serait de nature à faire faire des économies tout en résolvant les litiges. S’il faut saluer les avancées en matière de médiation (création du Conseil national de la médiation), ou encore accueillir avec intérêt les déjudiciarisations (réforme du changement de nom) ou déjudiciarisations partielles (formule exécutoire apposée sur les actes d’avocat), le juge doit demeurer un rempart qu’il faut urgemment renforcer et dont les fuites sont à colmater en urgence au risque d’un sinistre dont seront victimes, une fois de plus, les plus vulnérables.
La justice familiale ne peut pas fonctionner sans un juge solide travaillant de concert avec les avocat·es. Les états généraux de la justice doivent proposer des solutions en ce sens pour que soient mieux jugées nos procédures familiales :
• donner les moyens aux juridictions de rendre des décisions dans des délais raisonnables permettant des débats collectifs, sereins et apaisés en audience. Ces moyens permettront aux juges de statuer sans la pression qui est la leur et ses effets pervers sur notre relation de travail. Le caractère anxiogène du fonctionnement actuel nuit au bon fonctionnement de la justice familiale, ainsi qu’à nos conditions de travail ;
• solliciter davantage la profession d’avocat en amont, car ils sont les praticiens du réel avec une connaissance du terrain de nature à éclairer l’exécutif sur les difficultés rencontrées quotidiennement ;
• travailler ensemble, communiquer ensemble nonobstant la configuration des nouveaux palais, se comprendre pour mieux répondre aux attentes des justiciables qui ne doivent pas souffrir, quoi qu’il en coûte, des dysfonctionnements de la justice, s’agissant d’une autorité essentielle.
Florent Berdeaux est avocat et président de l’Association française des avocats de la famille et du patrimoine
Frédérique Eudier est professeur émérite
Fadela Houari est avocate au barreau de Paris, spécialisée en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine
Sophie Spens est magistrate, vice-présidente, coordinatrice du pôle famille du tribunal judiciaire de Metz
© DALLOZ 2022